« Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé » (Albert Einstein)
Compte-rendu de la conférence théatrale du 23 Mars 2025
Cette conférence sous forme de pièce de théatre mettait l’accent sur quelques femmes pionnières qui ont su défier les jugements préconçus.

7 d’entre elles ont particulièrement retenu notre attention : Sarah Bernhardt, comédienne au talent international ; Sophie Germain, mathématicienne admirée de C.F. Gauss ; Fanny Mendelssohn, sœur de Félix, mais surtout compositrice et pianiste virtuose ; Gabrielle Chanel dite Coco, inventrice de robes et de parfums sans égale ; Rosalind Franklin, découvreuse de la structure en double hélice de l’ADN ; Alice Guy, réalisatrice de cinéma et enfin Nellie Bly, journaliste. C’est sur ces 2 dernières femmes que nous allons mettre l’accent :
Alice Guy (1873-1968) est une réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma française, ayant travaillé en France et aux États-Unis.
Alice vient de loin : issue d’une famille bourgeoise son père lui a toujours dit : « Une femme ne doit pas avoir de métier, un point c’est tout ! ».
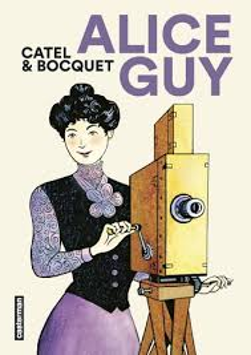
A la mort de ce dernier elle suit des études de sténodactylo pour participer aux besoins de sa mère et ses 3 sœurs. Elle devient secrétaire de Gaumont et le convainc de tourner un film. « La fée aux choux » en 1896 est l’un des tout premiers films de fiction au monde. Elle réussit dans ce milieu d’hommes parce qu’au début du cinéma on ne s’intéresse qu’aux documentaires venus de contrées plus ou moins exotiques. On ne prête guerre attention aux films de fiction, ce qui lui permet de montrer ses qualités, dans les multiples tâches que demandent la production et la réalisation d’un film.
Elle suit son mari aux Etats-Unis qui travaille également pour Gaumont mais qui l’abandonne bien vite pour céder aux charmes d’une actrice américaine. En 1922, divorcée, elle rentre en France avec ses 2 enfants mais ne trouve pas de travail dans le cinéma et écrit des contes dans la presse féminine.
Elle reçoit un jour un exemplaire d’un ouvrage sur les établissements Gaumont. Il est dédicacé par Léon Gaumont en personne. Malheureusement il n’est pas fait mention de son travail dans son entreprise, elle qui a pourtant réalisé une quinzaine de films chez lui !
Elle est nommée en 1955 chevalier de la légion d’honneur ; En 1957, à l’initiative de Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, elle reçoit un hommage de la Cinémathèque française.
En 1964 elle s’installe aux USA. Elle meurt d’une attaque cérébrale à 95 ans, sans avoir retrouvé ses films et en ayant tout oublié de son passé.
A dater des années 2000 son travail est enfin reconnu en même temps qu’un grand nombre de ses films est retrouvé.
Nellie Bly (1864- 1922) est une journaliste d’investigation américaine.
Elle suit des études pour être professeure mais son vrai désir est d’être journaliste. En 1880, elle est à Pittsburgh et lit dans le journal un article intitulé : « ce à quoi les jeunes filles sont bonnes ? ». La réponse subliminale est : « A élever les enfants et à tenir la maison ».
Le sang de Nellie ne fait qu’un tour. Elle écrit un article. Le rédacteur en chef est très surpris de la qualité de son écriture. Il la convoque. Et il l’engage. A 17 ans, la voilà journaliste, c’est à ce moment qu’elle prend son nom de plume sous lequel vous la connaissez ; car son vrai nom est Elizabeth Jane Cochrane.
Elle écrit un premier article, très documenté et agrémenté de photos, sur la condition des femmes dans une conserverie. Les femmes y travaillent dans des conditions épouvantables pour un salaire de misère. Le journal le publie et les exemplaires s’arrachent comme des petits pains. Mais, tous les industriels de la ville se plaignent au directeur du journal et elle est envoyée à la rubrique Culture, une rubrique typiquement féminine !
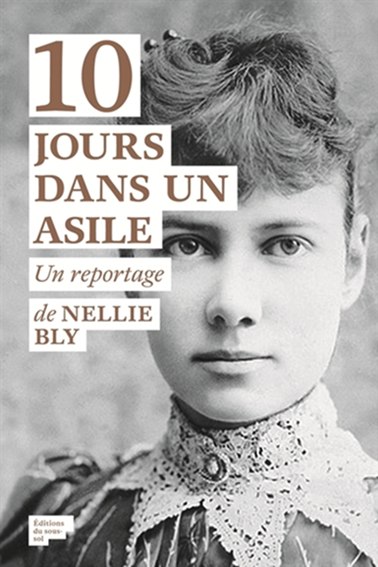
Elle quitte Pittsburgh pour New-York et fait le pied de grue devant les portes du « new York World » jusqu’à ce que le directeur lui accorde un entretien. Il s’appelle Joseph Pulitzer et lui propose un défi : se faire interner pendant 10 jours dans un asile pour femmes, le Blackwell’s Island Hospital et écrire un reportage sur cette immersion. Si elle accepte, il l’embauche. Mais problème, lui seul est au courant. Et s’il l’oublie … ou s’il décède brusquement, elle restera à vie dans cet asile.
Elle simule si bien la folie qu’elle se retrouve au commissariat de police où les agents, certains de sa démence, la font examiner par un médecin dont le diagnostic est sans appel : elle est complètement folle !
A la fin du terme fixé, Pulitzer vient la chercher. Elle était sur le point de devenir vraiment démente. Son article est publié. Elle devient alors la première journaliste d’investigation. Mais surtout ses critiques et recommandations ont été entendues. La ville de New York octroya un million de dollars supplémentaires à l’hôpital psychiatrique de Blackwell’s Island.
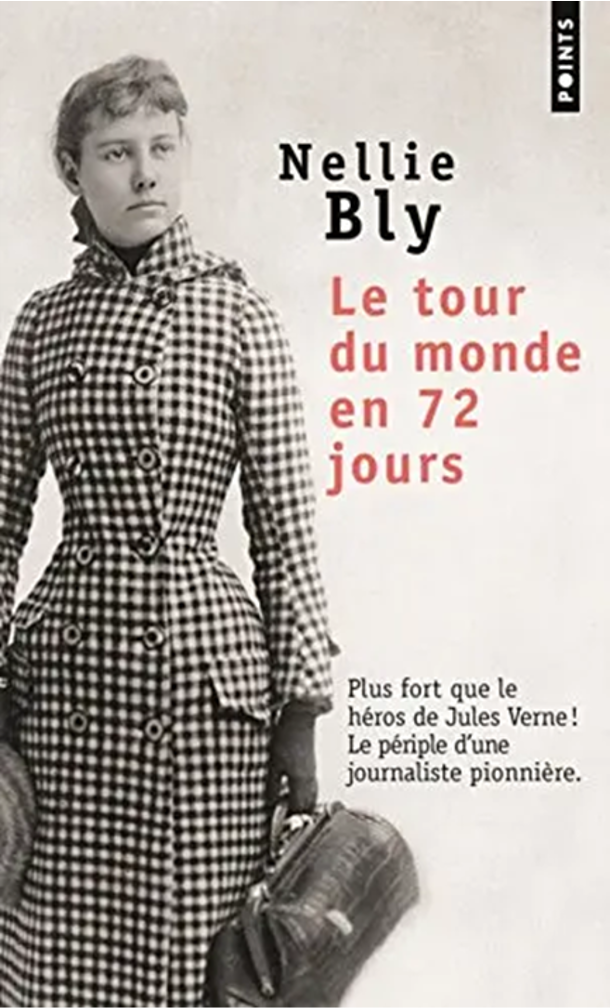
Après ce premier défi, elle s’en lance un autre. Celui de faire le tour du monde en moins de 80 jours pour battre le record de Phileas Fogg. Elle quitte le New Jersey le 14 novembre 1889, et après une courte escale à Amiens pour y rencontrer Jules Verne, elle réussit son périple en 72 jours 6 heures et 11 minutes.
Après d’autres aventures tout aussi exaltantes elle meurt en 1922 d’une pneumonie, à l’âge de 57 ans.
Un prix journalistique, le Nellie Bly Club Reporter, porte son nom. Il est décerné par le New York Press Club aux meilleurs travaux produits par de jeunes journalistes.
Bibliographie :
- « Dix jours dans un asile » (1887) de Nellie Bly / édition du sous-sol
Lire un extrait : https://www.amazon.fr/jours-dans-asile-Nellie-Bly/dp/2757859781?asin=B0D8TMJQVJ&revisionId=dc29b865&format=3&depth=1
- « Le tour du monde en soixante-douze jours » (1890) par Nellie Bly / édition « collection points »
Lire un extrait : https://www.babelio.com/livres/Bly-Le-tour-du-monde-en-72-jours/843990

